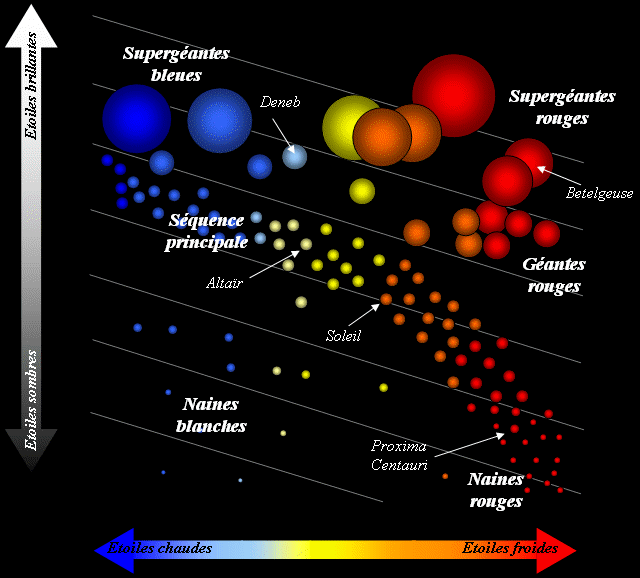A propos de ce blog
Nom du blog :
terreetmystere
Description du blog :
Quelques mots sur l'univers, la terre et les phénomènes qui y jouent, comme les geysers, les volcans
Catégorie :
Blog Sciences
Date de création :
07.09.2009
Dernière mise à jour :
20.09.2009

>> Toutes les rubriques <<
· 0 - Introduction (1)
· 1- Les liens de l'univers (13)
· 2 - La terre en émoi (1)
· 3 - Les mécanismes climatiques (0)
· 4 - Le visage de la terre (0)
· 5 - La vie sur la terre (0)
Accueil
Gérer mon blog
Créer un blog
Livre d'or terreetmystere
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
· 1.5 La force de gravité
· 1.6 Le rythme éternels des marées
· 1.4 Les aurores boréales
· 1.6 Le rythme éternels des marées (suite)
· 1.3 Le magnétisme terrestre (suite)
· 1.8 Les cycles de glaciation
· 1.3 Le magnétisme terrestre
· 1.4 Les aurores boréales (suite)
· 1.2 Anatomie du Soleil (suite)
· 1.2 Anatomie du Soleil
· 1.7 Météorites et comètes
· 1.7 Météorites et comètes (suite)
· 2 - La terre en émoi
· Introduction
· 1.1 Les liens de l'univers
Statistiques 15 articles
beau commentaire..h ttp://chez-mcm -collec.center blog.net
Par chez-mcm-collec, le 18.10.2014
bonjour,
vo us êtes cordialement invité à visiter mon blog.
description : mon blog(fermaton. over
Par clovis+simard, le 12.06.2011
bonjour,
vous êtes cordialement invité à visiter mon blog.
description : mon blog(fermaton. over-blog
Par clovis+simard, le 09.03.2011
super belle la photo!!
puis- je mettre vptre blog dans mes blog amis??
repond ez sur
http://willo uastro.
Par willou, le 03.10.2009

Introduction
La violente explosion d'un volcan, au milieu de la mer glacée, au sud de l'Islande le 14 novembre 1963, annonçait l'un des évènements les plus mystérieux des temps modernes : la naissance d'une îles nouvelle. Surtsey a donné aux scientifiques une occasion exceptionnelle d'étudier la colonisation d'une terre stérile par les plantes et les animaux et d'observer l'éclosion subtile de la vie sur la Terre.
Sur terre, maint lieux demeurent mystérieux. Beaucoup sont l'oeuvre de l'homme, mais plus nombreux encore sont les phénomènes et sites, admirable ou surprenants, engendrés par notre planète elle-même. Ces lieux secrets, ces évenements inexplicables font depuis longtemps l'objets d'investigations scientifiques approfondies : ils restent cependant magiques, car, pour convaincantes que soient les explications fournies par la science, certains de ces phénomènes demeurent de vastes énigmes pour le profane.
Ce blog nous entraîne dans un voyage à travers les prodiges de notre planète, des mieux connus au plus étranges. Certains relèvent de processus causés par des forces qu'oublient nos préoccupations quotidiennes, telles la gravité et les marées qu'elle provoque. D'autres résultent du puissant tavail qui s'effectue sous nos pieds et qu, par le déplacement lent mais inexorable des plaques continentales, donnes naissances aux volcans, aux séïsmes, aux geysers et aux raz de marée. Il existe aussi des merveilles climatiques aux rythmes lents, comme les fluctuations d'El Niño, les éclairs et les tornades ou des phénomènes exceptionnels tels que les "pluies rouges" ou les invraisemblables averse de grenouilles !
L'activité tellurique crée des paysages entiers, complexes et énigmatiques. Ce sont de curieux assemblages où géologie et biologie interfèrent comme dans la Rift Valley ou la mer des Sargasses ; ils ne peuvent que susciter l'émerveillement du spectateur.
Les forces mystérieuses de la nature apposent leur empreinte tabt à l'échelle planétaire que dans les plus infimes détails.
A une époque où l'avenir est devenu l'une de nos préoccupations principales, il est de la plus haute importance de percer les secrets du monde afin de mieux en préserver les splendeurs pour les générations futures.
1.1 Les liens de l'univers
Notre galaxie, la Voie Lactée, a une forme de spirale, semblable à Celle de la M33 (ci-dessus).
Le plus remarquable prodige de la nature est peut-être celui auquel nous prêtons le moins attention : nous vivons à la surface d'une mince couche de roche flottant sur de la lave en fusion et tournant sur elle-même dans l'espace.
Lorsque nous nous livrons à nos activités familiales ou professionnelles, nous navigons simultanément à travers l'immensité de l'espace insterstellaire, collés au sol de notre planète et seulement protégés par une mince couche d'atmosphère. Qu'y a-t-il de plus déroutant que le déroulement ordinaire de la vie à bord d'un vaisseau spatial d'aspect si vulnérable ?
Indéfiniment la Terre nous entraîne dans son mouvement de rotation sur elle-même à une vitesse de 800 km/h et son orbite autour du soleil nous impose des vitesses supérieures à 80 000 km/h. Enfin, vous-même et le reste du système solaire faites majestueusement le tour de la galaxie qu'est le Voie Lactée ! Cette galaxie que les Anciens ont ainsi nommée à cause de traînée laiteuse sous laquelle elle nous apparaît, n'a rien d'unique. Elle n'est qu'une des myriades de galaxies que compte l'Univers observable.
Nous ne songeons guère à la dimension cosmique de notre existence alors qu'elle intervient sans cesse dans notre vie quotidienne, le plus souvent d'une façon telle que seules les théories scientifiques modernes permettent de l'expliquer. Le Soleil et la Lune déterminent le mouvement des marées. Le Soleil est la dynamo qui entraîne les transformations climatiques, tant quotidiennement que par le jeu des variations d'orbite et de rotation de notre planète au long des millénaires. Les savants reconnaissent volontiers que nos connaissances dans ces domaines demeurent imprécises et partielles et que les théories actuelles comportent de nombreuses zones d'ombres.
Les Anciens utilisaient, pour comprendre le monde, des modèles explicatifs différents des nôtres. Leur compréhension des phénomènes mystérieux était moins détaillée, mais ils parvenaient néanmoins à fournir une description cohérente de l'Univers. Leur conception du cosmos englobait tout simplement moins de faits observables à expliquer.
Chaque époque commet l'erreur de penser que le savoir contemporain a définitivement franchi la barrière de l'ignorance et que la théorie la plus récente est La théorie, celle qui met fin à toute interrogation. Les physiciens par exemple croyaient bien être arrivés à ce stade au début de ce siècle, alors même qu'Albert Einstein s'apprêtait à faire voler en éclats leurs certitudes.
Peut-être croyons-nous savoir comment les influences cosmologiques affectent notre planète et notre vie, mais en fait, des domaines échappent encore à notre entendement. Nous n'avons ainsi qu'une vague notion de la manière dont les cycles des perturbations magnétiques à l'intérieur du Soleil affectent son activité, perçue sous la forme d'éruptions, de protubérances et de taches, qui elles-mêmes agissent sur le temps, les ondes radios, voire sur des phénomènes plus subtils comme la capacités des animaux à s'orienter.
D'une certaine façon, on peut dire qu'horoscopes, radiotéléscopes ou méthématiques supérieures ne sont en fait que trois des multiples moyens différents par lesquels les hommes ont tenté de conjurer leur effroi face à l'immensité inconnaissable de l'Univers. Nous ne devrions pourtant pas redouter les énigmes : "la plus belle chose que nous puissions expérimenter, c'est le mystère", disait Einstein.
1.2 Anatomie du Soleil
Les protubérances spectaculaires, nuages de matière plus dense et plus froide, qui se forment dans la couche gazeuse externe du Soleil, sont de remarquables indices de l'activité solaire. Cette image en fausses couleurs, photographiée de la station Skylab en 1978, fut l'une des plus importantes jamais enregistrées. L'éruption avait duré environ deux heures.
Que les peuples du monde aient tous, à un moment ou à un autre, adoré le Soleil ne saurait surprendre. Il semble logique qu'on lui ait attribué un pouvoir religieux face à la crainte que chacun éprouve devant une puissance aussi immense. Un astre qui procure sans faillir lumière et chaleur, qui fait pousser les récoltes et transforme la nuit en jour possède nombre d'attributs divins. La science moderne n'a rien fait d'autre que de chercher à expliquer les mécanismes régissant le pouvoir et l'influence spectaculaire du Soleil.
Depuis toujours, l'homme a été confronté à cette dualité : quels sont les liens qui unissent la Terre et le Soleil, et quel est l'origine de ces deux corps célestes ? Il y a là une énigme à laquelle tous les peuples, toutes les religions et toutes les cultures se sont un jour trouvés confrontés.
Presque tous les mythees et légendes relatant la génèse du monde relient l'origine de la Terre à celle des êtres humains. Cette puissance créatrice serait due à un dieu, souvent représenté sous la forme du Soleil. Les modèles modernes de la Création n'ont pas forcément recours à la volonté divine pour expliquer l'activité créatrice, mais les conceptions actuelles n'en sont pas moins vertigineuses.
Les cosmologistes modernes estiment que le Soleil et la Terre sont apparus presque simultanément, il y a de cela cinq milliards d'années, et qu'un immense nuage de gaz et de poussière fut à l'origine du système solaire tout entier. Sous l'effet de la gravité, le nuage se rétracta, concentrant la matière toujours plus au centre.
Ce processus finit par donner naissance à une masse en rotation avec un renflement central. Ce renflement continua à se comprimer sous l'effet de la gravitation pour former un corps de plus en plus dense jusqu'à ce que la température et la pression finissent par être suffisamment élevées pour provoquer une fusion thermonucléaire, comme au centre d'une bombe à hydrogène. Une étoile était née, qui commença à déverser un courant de chaleur et d'énergie lumineuse qui s'est maintenu pendant plus de quatre milliards d'années. Ce qui restait du disque de matière provenant du nuage détermina le plan orbital des futures planètes du système solaire, puis la poussière et le gaz du disque se solidifièrent pour constituer les planètes.
En 1908, un physicien américain Hermann Helmholtz, émit l'hypothèse que le Soleil était formé d'un mélange d'hydrogène et d'oxygène, sa lumière et sa chaleur étant produites par la combustion de ces deux gaz. A l'époque, on accorda quelque crédit à cette idée car on savait déjà que le Soleil était essentiellement constitué d'hydrogène. Helmholtz découvrit que, bien que le diamètre du Soleil fut de 1,3 millions de kilomètres (soit plus de cent fois celui de la Terre), il serait, à ce rythme de consommation, à court de carburant dans 3000 ans environ. Comme le Soleil existe depuis plus de quatre milliards d'années, de toute évidence cette explication n'était pas plausible.
Vingt ans avant les calculs de Helmholtz, l'astronome britannique Norman Lockyer avait essayé d'élucider le mystère de l'énigmatique source d'énergie du Soleil en émettant une hypothèse encore plus extravagante. Il suggéra que toute les étoiles tiraient leur énergie d'un bombardement constant de leur surface par un grand nombre de météorites ; mais cette théorie n'expliquait pas pour autant l'immense durée de production d'énergie produite par notre étoile.
C'est en 1914 qu'un astronome américain, Henry Russell, et un Danois, Ejnar Herzsprung, donnèrent une explication de la production d'énergie des étoiles qui se rapproche de nos conceptions actuelles. Ils publièrent une description des relations entre la brillance et la couleur des étoiles selon leur âge : c'est le célèbre diagramme de Herzsprung et Russell. Ces découvertes attirèrent l'attention sur les mécanismes de la production d'énergie dans les étoiles. Au début, Russell pensait que l'énergie provenait de la destruction réciproque de protons (positifs) et d'électrons (négatifs). Bien que cette théorie se révélât fausse, elle marqua toutefois une avancée importante.
1.2 Anatomie du Soleil (suite)
Diagramme De Herzsprung et Russell.
Mais c'est pendant les années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale que l'on fit une découverte fondamentale. En 1927, Arthur Eddington, sachant que les deux gaz principaux contenus dans le Soleil étaient l'hydrogène et l'hélium, émit l'hypothèse que la source d'énergie était la transmutation de ces éléments. Sous l'effet de pressions et de températures suffisamment élevées, les noyaux d'hydrogène fusionnaient pour constituer des noyaux d'hélium, et ce processus de fusion nucléaire provoquait la libération d'énormes quantités d'énergie. Le calcul permit de démontrer que si l'hydrogène était "brûler" de cette façon il pouvait durer plusieurs milliards d'années.
La théorie de la fusion d'Eddington fut affinée en 1939 par le physicien américain Hans Bethe, qui comprit que le petit nombre de noyaux de carbone contenus dans le Soleil agissait comme une sorte de catalyseur auto-renouvelable provoquant la fusion de l'hydrogène. Cette hypothèse constitue la base de la conception moderne de la production d'énergie par les étoiles.
Mais cette dynamique interne du Soleil ne peut être dissociée de la compréhension de son organisation interne qui échappe à notre perception immédiate. Au coeur du Soleil se trouve un noyau d'hydrogène soumis à des températures et des pressions considérables. Les noyaux d'hydrogène y sont comprimés les uns contre les autres à des températures d'environ 15 millions de degrés ; ils forment un matériau douze fois plus dense que le plomb. Dans ces conditions extrêmes, cette formidable masse d'énergie, qui fonctionne comme une gigantesque bombe à hydrogène, est en état d'explosion permanente.
L'énergie émise par le noyau se propage par radiation vers la surface du Soleil, jusqu'à la zone dite de convection externe dont l'épaisseur est de 100 000 km environ. A partir de cette zone, la plus grande partie de l'énergie se déplace à travers le gaz grâce à de violents mouvements de convection. La partie visible du Soleil est la photosphère, dont la température s'élève à 6 000 °C environ. Autour d'elle se trouve l'atmosphère ténue du Soleil, la couronne, qui est beaucoup moins lumineuse et d'où émane le "vent solaire", flot permanent de particules énergétiques qui s'échappent du Soleil.
La forme sphérique apparfemment parfaite du Soleil et sa surface irradiante sont en réalité troublées par divers phénomènes, dont certains ont un caractère cyclique, liés à ses propriétes magnétiques. D'importantes éruptions et protubérances se forment parfois à la surface du soleil et des taches sombres relativement froides apparaissent, se déplacent puis disparaissent. Le nombre de taches solaires augmente et diminue selon une périodicité de onze ans ; elles sont soumises à un cycle d'inversion de la polarité du champs magnétique solaire que l'on peut mesurer : il dure vingt-deux ans. On a souvent tenté de montrer que ce cycle agissait sur le temps, le comportement humain, et avait une influence sur les événements historiques importants. On est à peu près sûr que certains phénomènes météorologiques suivent le même cycle. Cela est, sans doute, lié à l'activité solaire.
La position cosmique de la Terre par rapport au Soleil et aux autres corps célestes a toujours été profondément mystérieuse. L'histoire de la compréhension progressive d'un phénomène est une suite passionnante d'intuitions, de longues périodes de confision, ponctuées de faux départs qui aboutit finalement à l'établissement d'un consensus offrant une image claire de notre grille de référence cosmologique.
La conception primitive d'une Terre plate et immobile est facile à comprendre. Pour un simple observateur, aucun signe évident ne peut réfuter cette apparence. Ainsi le philosophe grec Thalès de Milet, qui vécut plus de cinq siècles avant notre ère, pensait que le monde était un disque plat flottant sur l'eau. Sa théorie ne fut sérieusement remise en question que lorsque certaines observations astronomiques rendirent obsolète cette vision simpliste du monde.
En particulier, des étoiles brillantes et facilement reconnaissables étaient visibles à certaines époques de l'année dans certaines parties du monde connu mais jamais dans d'autres. L'étoile Canopus, par exemple, était visible à Alexandrie, dans le nord de l'Afrique, mais n'apparaissait jamais dans le ciel d'Athènes. La seule explication simple résidait dans le fait que la surface de la Terre était courbe, donc, en Grèce continentale, Canopus était toujours au-dessous de l'horizon.
Comme les Grecs éprouvaient un respect mystique pour le sphère, qu'ils considéraient comme une forme idéale, il semble naturel qu'ils aient étendu cette notion de surface courbe à la conception d'une Terre ayant une forme de sphère. Cette conception bouleversa toutes les connaissances jusque-là admises.
La notion d'une Terre sphérique permettait de surcroît d'expliquer pourquoi l'ombre de la Terre, qui provoque les éclipses et les solstices, était elle-même circulaire. Voici maintenant quarante et un siècles, les habitants de la Terre prévoyaient déjà l'apparition périodique des éclipses et des solstices. Par exemple, le remarquable site de Stonehenge, aménagé par les hommes du néolithique dans le sud de l'Angleterre, servait sans doute de temple mais aussi de calculateur astronomique. L'observation du Soleil, et de la Lune à travers des cercles compliqués de pierres disposées avec soin leur permettait très certainement de prédire les éclipses.
Même quand l'idée d'une Terre pleine et sphérique commença à être admise, il fut difficile aux premiers penseurs et philosophes de renoncer aux préjugés les plus tenaces, selon lesquels la Terre où nous vivons est nécessairement au centre de l'Univers. Dans la conception grecque classique, le Soleil, le Lune et les étoiles tournaient autour d'une Terre stationnaire en décrivant des chemins circulaires.
Les mouvements des planètes, les planaomai ("vagabonds") grecs, étaient moins faciles à expliquer parce que leurs tracés étaient irréguliers par rapport aux positions "fixes" des étoiles. Mais le génie frd Grecs leur permit de surmonter la difficulté et d'élaborer une théorie, le système de Ptolémée, codifiant la course des planètes selon des cercles à l'intérieur d'autres cercles : les épicycles. Cet engrenage cosmologique permit de prédire de manière approximative le mouvement des planètes et des étoiles.
Certains Grecs, francs-tireurs intellectuels de leur temps, remirent toutefois en cause l'orthodoxie d'un Univers centré autour de la Terre. Vers l'an 250 avant notre ère, Aristarque de Samos fut le premier à émettre l'hypothèse que la Terre tournait autour du Soleil selon une orbite circulaire qu'elle effectuait en une année. Il aboutit aussi à la conclusion que le Soleil était plus vaste que la Terre et que la rotation de celle-ci sur son axe était à l'origine du jour et de la nuit. Sa perspicacité le fit passer pour un illuminé.
Ce n'est qu'en 1530, près de mille huit cent ans plus tard, que cette intuition fut réaffirmée avec autorité par le prêtre polonais, Nicolas Copernic (1473 - 1543). Son idée d'un Univers centré autour du Soleil suscita aussitôt une violente opposition des Églises.
Martin Luther déclara au sujet de l'oeuvre de Copernic : "Cet imbécile tente de renverser tout l'art de l'astronomie." Et c'est en effet ce qu'il fit. Il détruisit de façon irréversible le système de Ptolémée.
1.3 Le magnétisme terrestre
Avec une précision étonnante, les oiseaux migrateurs, comme ces oies bernaches, reviennent sur les mêmes lieux tous les ans. On pense qu'ils naviguent en s'aidant du Soleil, des étoiles, de repères au sol et du champ magnétique terrestre, qui influencent peu les êtres humains. Nous comprenons mal ce don inné mais nous savons l'exploiter ; comme dans le cas des pigeons voyageurs attendant d'être libérés pour transporter des messages quand toute autre forme de communication est impossible, en temps de guerre par exemple.
Nous considérons presque tous qu'il existe deux types de science ; l'une est fondée sur le bon sens et l'autre échappe à notre entendement. La première concerne ce qui va de soi, l'expérience habituelle et ce que nous croyons naïvement être l'explication de ce qui se passe autour de nous. Nous ne sommes guère étonnés qu'une flamme fasse chauffer une bouilloire ne que de l'eau froide ajoutée à de l'eau bouillante donne de l'eau tiède.
L'autre type de science demeure mystérieux et son influence sur notre vie quotidienne nous échappe. La physique quantique, par exemple, a apporté une autre vision de la structure de l'Univers. La matière et l'énergie auraient une structure discontinue ; elles n'existeraient que sous forme de particules ininitésimales : les quantas. Mais le quantum ne joue aucun rôle dans nos préoccupations de tous les jours.
Le magnétisme est tout autre chose. Mais il fait partie de notre vie courante. Pour quelques francs, on peut acquérir un jouet d'enfant fonctionnant grâce à de petits aimants qui se repoussent l'un l'autre, et la boussole munie d'une aiguille aimantée est un appareil répandu qui a été utilisé par toutes les civilisations techniciennes. Mais si nous prenions la peine d'y réfléchir un instant, les jouets et la boussole pourraient nous terrifier. La capacité que possède un aimant d'en faire bouger un autre, sans contact entre eux, tient de la magie
Le pouvoir mystérieux de l'électromagnétisme, conjugaison d'effets électricques et magnétiques indissociables, a une portée universelle. C'est un effet de l'attraction électromagnétique, c'est-à-dire l'attraction d'une charge positive pour une charge négative ou d'un pôle nord par un pôle sud, qui fait fonctionner un moteur électrique ou la dynamo d'une centrale. C'est la même attraction qui, à une échelle bien inférieure, assure la cohésion de l'atome.
Chaque atome est organisé comme un système solaire en miniature. Le "soleil" de ce système est le noyau de l'atome. Il en contient presque toute sa masse et il est chargé positivement. Autour du noyau gravitent des électrons chargés négativement, maintenus en "orbite" par des forces électromagnétiques. L'atome n'existerait pas sans cette attraction qui assure la cohésion de ses divers éléments. Et sans les atomes, les soleils, les planètes et les êtres n'existeraient pas non plus.
Notre planète est soumise à un champ magnétique important. Son existence est vérifiée par le fait que l'aiguille de la boussole s'aligne sur l'axe du champs magnétique terrestre. Dans l'hémisphère Nord, l'aiguille s'oriente vers le pôle magnétique nord ; dans l'hémisphère Sud, vers le pôle magnétique sud. Sur le plan magnétique, la Terre se comporte presque comme si elle était traversée par un gigantesque aimant droit, possédant un pôle à chaque extrémité. Chacun de ces pôles est écarté d'environ onze degrés des pôles géographiques réels, qui sont définis par l'axe autour duquel la Terre pivote.
Entre les deux pôles magnétiques s'étendent les lignes de force invisibles du champs magnétique de la planète. Ce champ de force dessine, sur tous les paysages, un quadrillage invisible, semblable à celui d'une carte, pour les êtres vivants qui ont la capacité d'en percevoir la force et la direction. Les savants commencent seulement à découvrir à quel point l'influence de ce champs magnétique agit sur les êtres vivants. Les bactéries, les poissons, les oiseaux et peut-être même les hommes peuvent suivre une destination particulière grâce à leur aptitude à percevoir la direction du champs magnétique terrestre. Et l'on pense que les sourciers, qui possèdent le pouvoir mystérieux de découvrir des substances souterraines à l'aide d'une simple baguette ou d'un bâton fourchu, sont sensibles aux faibles variations électromagnétiques produites par l'au ou les minéraux.
Les chercheurs n'ont encore qu'une idée assez vague de l'origine du magnétisme terrestre. Le fait que son intensité et sa direction varient d'une année à l'autre et d'un millénaire à l'autre donne à penser qu'il n'est pas dû à une structure magnétique rigide enfouie dans les entrailles de la Terre. Les hypothèses les plus convaincantes, en l'état actuel de nos connaissances, sont que les magnétisme résulte des mouvements induits par la chaleur dans les métaux fortement ferreux situés au coeur de la Terre ou à proximité.
1.3 Le magnétisme terrestre (suite)
Francis Drake, le corsaire de l'époque élisabéthaine, fut le premier homme à faire le tour du monde à la voile, en passant par le cap Horn, les Indes orientales et le cap de Bonne-Espérance, et à raconter son exploit à son retour. Comme le montre cette copie duGolden Hind, son vaisseaux de 100 tonneaux et 60 m de long était minuscule, comparé aux navires modernes, mais son commandant, équipé des instruments de navigation les plus sophistiqués à l'époque, avait une telle soif d'aventure et de butin qu'elle lui donna des ailes et lui permit de rentrer à bon port en 1580, après un périple de trois ans.
Le coeur de la Terre mesure approximativement 3 600 km de diamètre et est constitué par le noyau central solide et une couche externe dont on pense qu'elle st de nature fluide. L'élément ferreux de ce noyau métallique rst un bon conducteur de l'électricité. Or, on constate que les courants électriques qui traversent les conducteurs donnent naissance à des champs magnétiques, tandis que les conducteurs se déplaçant dans un champs magnétique sont le siège de courants induits. Cette remarquable symétrie de l'interaction entre courant, mouvement et magnétisme fournit une hypothèse expliquant comme le coeur de la Terre pourrait créer le champs magnétique terrestre. C'est la théorie de la dynamo autoexcitée. Si le fer liquide, conducteur, du coeur de la Terre circule constamment sous l'effet de la chaleur et rencontre le moindre champ magnétique, un courant apparaîtra dans le métal en mouvement. Ce courant créera à son tour un champ magnétique qui produira encore plus de courant. Un tel système représente une réaction auto-entretenue ("feedback"); et si la circulation du métal est continuellement maintenue par la convection de la chaleur, il est possible de concevoir la production perpétuelle d'un champ magnétique. Il suffit pour amorcer le processus d'une sorte de magnétisation initiale. Comme le nickel et le fer du coeur de la Terre peuvent être facilement magnétisés, il n'est pas difficile d'imaginer l'existence d'un magnétisme fondamental dans le noyau solide qui aurait été à l'origine d'un tel processus dans la couche fluide toujours en mouvement.
Dans l'histoire de l'humanité, l'utilisation la plus importante du magnétisme a été, sans conteste, l'emploi de la boussole pour la navigation en haute mer. Une aiguille magnétisée capable de tourner librement s'aligne sur le champ magnétique terrestre et, indique donc, dans l'hémisphère Nord, la direction du pôle magnétique nord.
La capacité de s'orienter sur terre comme sur mer, lorsque ni le Soleil ni les étoiles ne sont visibles, offre des possibilités immenses qui ont été utilisées par tousles grands voyageurs du passé. Les anciens Grecs connaissaient les étranges propriétés de la magnétite, mineral de fer naturel, mais ce sont probablement les Chinois qui, dès le Ier siècle avant notre ère, utilisèrent cette pierre pour fabriquer la première boussole.
Toutefois, la boussole n'est guère plus précise que les lignes de force magnétiques qui la dirigent. Ces dernières ne sont malheureusement pas les mêmes partout. L'un des problèmes est celui causé par l'écart en un point quelconque de la surface du globe entre le nord magnétique et le nord géographique. Cette déclinaison varie de manière assez complexe, et la lecture de la boussole ne peut donner d'indications précises que lorsqu'on connaît parfaitement les rapports entre le nord géographique et le nord magnétique.
En Grande-Bretagne, par exemple, le nord de la boussole est situé dix degrés à l'ouest du nord géographique alors qu'au milieu de la Méditérranée l'écart de déclinaison est voisin de zéro. Plus on se rapproche des pôles magnétiques, plus les erreurs de l'angle de déclinaison, les déviations de l'aiguille de la boussole, à l'est ou à l'ouest du nord géographique, sont importantes. Cet écart a toujours été un des grands problèmes rencontrés par les explorateurs polaires.
Non seulement la déclanaison varie avec la situation géographique, mais encore les pôles magnétiques se déplacent avec le temps, et l'intensité du champ varie elle aussi. Ces variations compliquées impliquent la remise à jour régulière des cartes marines en ce qui concerne le nord magnétique, afin d'éviter le cumul des erreurs de navigation.
Ces aspects pratiques du magnétisme terrestre mettent en relief un vérité profonde du phénomène lui-même. Il ne s'agit en aucune façon de la grille fice que la lecture des atlas laisse supposer. Le magnétisme terrestre est plutôt une notion dynamique, aussi constante, aussi changeante que le climat, les paysages ou la position des continents qui dérivent. Ainsi, considérée sur de longues durées, une grande variation magnétique a été mise en évidence, qui a d'abord servi de preuve à la dérive des continents elle-même : c'est le paléomagnétisme, le magnétisme qui subsiste dans les roches les plus anciennes.
Quand les roches fondues se solidifient pour la première fois, de minuscules particules magnétiques s'alignent sur le champs magnétique existant alors, indiquant la direction du pôle magnétique nord ou sud. L'étude des roches qui se sont solidifiées au cours des dernières cinquante millions d'années montre qu'à des intervalles de temps irréguliers, de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années, la polarité du champ magnétique terrestre s'est inversée de manière inexplicable, le pôle magnétique nord devenant le pôle magnétique sud, et vice versa. Rien n'illustre mieux le dynamisme du mystérieux magnétisme de la Terre que ces curieux changements.
1.4 Les aurores boréales
Voici comment le poète américain Bayard Taylor décrivait en 1864 la beauté capricieuse d'une aurore boréale : "Un large rideau de lumière [s'abattit] tout droit jusqu'à ce que son ourlet frangé parût flotter à quelques mètres seulement au-dessus de nos têtes. Il pendait à l'aplomb du zénith, paraissant franchir des millions de lieues dans sa chute à travers les airs, ses plis rassemblés au milieu des étoiles et ses broderies de flamme balayant la terre en baignant d'une pâle lueur irréelle la lande neigeuse."
La lumière des aurores boréales est l'un des spectacles les plus grandioses que l'on puisse admirer. Des arcs et des bandes violet et bleu chatoyants sillonnent l'obscurité de la nuit polaire, des raies d'un vert éclatant, dont la pointe rouge étincelle, strient le ciel. Des pans de matières blanches aux formes complexes se meuvent et se mélangent plusieurs fois par minute. Enfin des taches de lumière, animées de vibrations, offrent un spectacle semblable aux plus beaux couchers de soleil, mais en mouvement perpétuel.
Si les mécanismes en sont aujourd'hui bien connus, les aurores boréales sont pourtant restées pendant des centaines d'années une curiosité scientifique et leur existence demeure entourée de mystère. Contrairement aux arcs-en-ciel, dont la position semblent changer en fonction de celle de l'observateur, l'aurore boréale naît toujours en des points précis dans la haute atmosphère, qui ont l'apparence d'arcs ou de rayons semblables à des flammes. Mais leur lumière étrange et irréelle n'est pas le résultat d'une combustion ; elle ressemble plutôt à la lueur provoquée par des décharges électriques dans un milieu fluorescent.
Les aurores boréales et australes apparaissent le plus souvent sous la forme de deux bandes entourant les pôles, et se déplacent généralement d'ouest en est. Elles sont presque perpendiculaies à la direction de l'aiguille de la boussole, ce qui laisserait supposer qu'elles dépendent du cham magnétique terrestre.
C'est dans les régions arctiques, en particulier au nord du Canada, en Alaska, au nord de la Norvège et au Spitzberg, que l'on observe les plus belles aurores boréales, parce que les ciels sont plus obscurs en plus dégagés que ceux qui couvrent les régions fortement peuplées d'Europe. Le meilleur moment de l'année pour contempler les aurores boréales est le mois de février, quand les zones de haute pression barométrique demeurent stationnaires au-dessus des régions polaires durant plusieurs semaines d'affilée.
Pendant cette période, on peut observer des aurores presque toutes les nuits quand le ciel est dégagé ; elles sont toutefois beaucoup moins visibles au clair de lune. On parvient à apercevoir les étoiles les plus brillantes à travers la lumière aurorale, mais les aurores les plus intenses fournissent suffisamment de lumière pour permettre de lire en pleine nuit.
Les aurores se présentent généralement comme une longue bande ondulée mais il arrive qu'elles ne soient qu'une masse diffuse, informe mais lumineuse. Si l'aurore se trouve presque au-dessus de notre tête, la bande, vue de côté, semble étonnamment mince et profonde, pouvant atteindre jusqu'à 800 km d'altitude.
Les aurores les plus hautes se produisent habituellement dans les couches de l'atmosphère que traversent les rayons du Soleil, même lorsqu'il se trouve sous l'horizon. A cause de la courbure de la Terre, les aurores qui semblent basses à l'horizon se trouvent en réalité très haut dans le ciel, à des centaines de kilomètres de distance.
Certaines aurores semblent constituées d'une succession de formes aux couleurs délicates, mais les orages boréaux classiques (qui coïncident généralement avec des perturbations magnétiques) apparaissent suivant un schéma bien défini qui comportes cinq étapes distinctes. La première manifestation d'une aurore est l'apparition d'un arc de lumière verte, l'arc au repos, au nord dans le ciel peu après le coucher du Soleil.
Cet arc est formé d'un voile lumineux vertical de quelques centaines de mètres d'épaisseur seulement, qui suit une ligne de latitude géomagnétique. Il peu s'étendre sur des centaines, voire des milliers de kilomètres et se maintient généralement une heure sans grand changement. Si la perturbation magnétique disparaît, l'arc s'évanouit, mais, si elle augmente, le phénomène entre dans la phase de l'arc actif.
La pointe inférieure de l'arc s'effile alors en s'illuminant fortement, puis devient bleuâtre, et se déplace rapidement vers le sud. L'arc change ensuite de forme et éclate en rayons parallèles ou gerbes de rayons qui s'élèvent jusqu'au zénith et dérive habituellement vers l'ouest le long de l'arc. Si le phénomène s'amplifie encore, un troisième stade commence alors, celui de la couronne aurorale.
C'est plus spectaculaire, bien qu'il soit de courte durée. Le voile auroral est maintenant presque au-dessus de l'observateur, qui peut apercevoir une forme circulaire semblable à une couronne ornée de rayons et de cannelures qui paraissent converger. Il arrive que la couronne se transforme en un arc ou un éventail de lumière qui s'ouvre dans le ciel. Parfois aussi, la couronne se met à palpiter rapidement et émet des milliers de rayons qui tombent telles des averses de flèches.
1.4 Les aurores boréales (suite)
En étudiant des photographies d'aurores boréales prises au même moment en plusieurs points d'observation reliés par téléphone, le Norvégien Carl Stormer réussit à en déterminer la position exacte dans l'atmosphère.
Lorsque la couronne s'est estompée, il s'ensuit une période d'activité aurorale désordonnée appelée des "Joyeux danseurs" aux îles Shetland. Des bandes ou des taches de lumière, accompagnées parfois de flammes qui naissent et disparaissent comme des pulsations, offrent le spectacle le plus grandiose des aurores boréales.
Les aurores boréales dépendent du champs magnétique terrestre, mais cela n'explique pas leur vraie cause. Le philosophe grec Aristote ayant observé la pulsations de leurs couleurs éclatantes en déduisit que l'air se changeait en feu liquide. On pense désormais depuis plusieurs années que les aurores sont constituées de particules émises par le Soleil qui se déplacent à des vitesses si élevées qu'elles réussissent à pénétrer dans la couche supérieure de l'atmosphère, l'ionosphère. L'invasion de ces particules lancées à grande vitesse active les molécules d'air, qui deviennent lumineuse et donnent naissance à la lumière aurorale. Les différents types de particules. Les aurores brillantes, emplissant tout le ciel et comportant tous les stades du cycle, sont causées par les éruptions solaires qui produisent dans les zones actives de la surface du Soleil. De ce fait, leur intensité varie avec le cycle des taches solaires, les phénomènes les plus surprenants et les plus fréquents survenant deux ou trois ans après les périodes d'activité maximale des taches du Soleil.
Divers points restent toutefois inexpliqués par la science. La cause des innombrables variations des formes colorées et des fines structures des aurores fait toujours l'objet d'interrogations. Et rien ne permet encore d'expliquer ce fait curieux, noté par des observateurs : la formation d'aurores entre elles et des montagnes éloignées.
Les aurores ont acquis une importance pratique dans les années 20, quand les ondes radio furent projetées pour la première fois contre l'atmosphère pour augmenter la portée des communications. On découvrit que les aurores absorbaient une partie des signaux radio tout en provoquant une réflection particulière des autres. De nos jours les signaux radio transmis à partir de satellites traversent directement l'ionosphère et sont beaucoup moins affectés.
Plusieurs questions concernant les aurores restent encore sans réponse. Dans la haute atmosphère, par exemple, des champs électriques éphémères acommpagnent souvent les aurores et provoquent des courants électriques à la surface de la Terre. Ces courants interfèrent à leur tour sur les transmissions télégraphiques et téléphoniques par des câbles, ou sur la précision des mesures fournies par les instruments servant à repérer les gisements de pétrole ou de minerais. De forts courants peuvent même projeter les coupe-circuit dans les lignes à haute tension, provoquant des pannes générales comme ce fut le cas au Québec en mars 1989.
Faits plus étrange encore, beaucoup de gens font état de craquements ou de froissements lors d'aurores particulièrement violentes. Ces bruits qui ne sont pas provoqués par les ondes sonores créées par les aurores, pourraient être produits au niveau du sol sous l'effet de phénomènes électriques et/ou magnétiques non encore identifiés. Les aurores conservent encore une partie de leur mystère.
1.5 La force de gravité
Les chutes d'Iguaçu, à la frontière du Brésil et de l'Argentine, offrent un exemple spectaculaire de la force de gravité. "C'est un océan qui se déverse dans un abîme", a pu dire le botaniste Suisse Robert Chodat. En ces lieux, 275 chutes distinctes dévalent les 82 m qui séparent le rebord supérieur, large de 4 km, de l'étroit défilé connu sous le nom de gorge du Diable. Les eaux serpentent ensuite à travrs le plateau jusqu'au Rio Parana, à 22 km plus au sud.
Un enfant laisse tomber sa cuillère : elle tombe par terre sous l'effet de la gravité. Vous chaussez vos skis en haut d'une piste et vous vous laissez glisser vers le bas : une force gravitationnelle vous entraîne le long de la pente. La Lune tourne en orbite autour de la Terre : son mouvement circulaire est provioqué par la force de gravité. Il en est de même pour les planètes, les comètes et les astéroïdes qui tournent en orbite autour u Soleil. Et c'est la même force qui anime ke disque majestueux de notre Voie lactée, lequel mesure plus de 100 000 années-lumière de diamètre.
Ces quelques exemples illustrent l'ubiquité et l'omnipotence de la gravité. Contrairement à la plupart des autres forces, elle semble agir avec une intensité égale à toutes les échelles, du microscopique à l'astronomique. Mais il fallut l'immense intelligence d'Isaac Newton pour en comprendre le principe sous-jacent. En 1687, comme l'histoire nous le raconte, Newton réfléchit aux conséquences de la chute d'une pomme dans son verger, puis il publia son ouvrage fondamental, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principes mathématiques de la philosophie naturelle), connu sous le nom de Principes. L'ouvrage traitait de nombreux sujets, mais, surtout, il énonçait la loi de la gravitation universelle, qui pose comme principe fondamental de l'Univers que toute matière attire n'importe quelle autre matière par le jeu d'une force gravitationnelle. L'intensité de cette force dépend de la masse des corps qui s'attirent mutuellement et elle décroît rapidement, en proportion inverse du carré de leur éloignement, au fur et à mesure que la distance de ces corps augmente. Cette affirmation d'une élégante et profonde simplicité permettait de prédire à la fois la chute de la pomme et la mise sur orbite des planètes.
La gravité est indubitablement la force qui régit à une grande échelle le comportement de tous les éléments de l'Univers. Tout objet de grande taille, qu'il s'agisse d'une planète, d'une étoile ou d'une galaxie, est entouré d'un champ gravitationnel. Aujourd'hui, suivant les théories d'Einstein, ce champ est souvent conçu comme un "puits de gravité" (un creux ou une dépression) dans le tissus de l'espace-temps dont la profondeur est déterminée par la quantité de matière qui constitue l'objet. Cette courbure ou ce "gauchissement" de l'espace-temps oblige toute matière ou toute forme d'énergie, telle que la lumière, à se courber lorsqu'elle traverse le champs gravitationnel d'objets de grande taille, comme les étoiles.
Les autres objets ou courants de radiations qui pénètrent dans ces dépressions glissent en elles ; autrement dit, ils sont influencés par la force gravitationnelle. Lorsqu'un vaisseau spatial sort du puits de gravité de la Terre, les influences gravitationnelles résiduelles sont faibles et tous les objets logés dans le vaisseau sont en apesanteur. Le poids (la masse) d'un objet n'est que la force gravitationnelle qui agit sur lui en un lieu donné.
Les progrès scientifiques accomplis au XXe siècle ont complétés de diverses manières l'édifice bâti par Newton. Grâce à la théorie de la relativité d'Einstein, nous savons désormais que la masse et l'énergie sont équivalentes. L'une peut se changer en l'autre, entraînant les effets dévastateurs d'une bombe atomique.
Nous n'avons également pas hésité à imaginer des objets d'une densité assez élevée pour que leur puits gravitationnel soit si profond et si escarpé que rien ne puisse s'en échapper. Cet objet est le fameux "trou noir", entité cosmologique dont la gravité est si forte qu'elle empêche même la lumière de s'échapper. De telles masses mystérieuses existent peut-être au coeur de nombreuses galaxies, formant un noyau immense et pourtant invisible autour duquel tournent les myriades de soleils de la galaxie.
Les spéculations sur les mystères de la gravité sont allées plus loin encore. De même qu'une charge électrique animée d'un mouvement ou d'une vibration émet des ondes électromagnétiques, on a émis l'hypothèse qu'une grande masse vibrante puisse produire des ondes gravitationnelles, ou perturbations du champ gravitationnel, semblables à des rides qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Diverses expériences de laboratoire sont actuellement en cours pour tenter de démontrer l'existence de telles ondes. Aucune de ces tentatives n'a encore fourni de résultats positifs qui ne soit sujet à contreverse. Mais nous espérons beaucoup qu'une supernova (explosion stellaire cataclysmique) qui vient d'être observée tout récemment émettra des ondes gravitationnelles détectables.
Notre aptitude à explorer le mystérieux a été à l'origine, au cours de la dernière décennie, d'une multitude de "théories du tout", visant à établir des liens entre toutes les forces de la nature, y comprit de la gravité. Les connaissances actuelles laissent supposer qu'à des niveaux d'énergie normaux quatre forces agissent. Ce serait la gravité, la force électromagnétique et les forces nucléaires dites faible et forte, qui assurent la structure du noyau de l'atome. Les deux dernières agissent seulement à de courtes distances alors que la gravité et l'électromagnétisme produisent des effets à des distances infinies.
La gravité est de loin la plus petite des quatres ; les autres sont au moins 10 Exp 35 (c'est-à-dire 1 suivi de 35 zéros) fois plus grandes. En dépit de son infime éfficacité, c'est la gravité qui est la force dominante à l'échelle astronomique, car elle opère à n'importe quelle distance.
L'Univers étant électromagnétiquement neutre, les forces électromagnétiques n'affectent pas les mouvements cosmologiques : toute charge positive est contrebalancée par une force négative correspondante.
Certains savants ont soutenu l'idée qu'à des niveau d'énergie de plus en plus élevés ces quatre forces de natures très différentes pourraient se fondre en une force unique. Ces énergies d'une importance suffisante n'ont peut-être exister qu'au moment du "Big Bang", l'explosion qui a marqué le début de l'Univers. Si c'était le cas, un déploiement majestueux et mystérieux de la nature se serait produit dans les premiers instants de cet évènement, au moment où les forces seraient apparues et où la matière aurait commencé à exister.
1.6 Le rythme éternels des marées
La pleine lune au-dessus d'une mer d'argent, semble le comble de la tranquilité, mais le calme de la scène masque une activité constante. Car c'est la puissance mystérieuse de la Lune qui est en grande partie responsable de la variation et du mouvement incessant des marées océaniques et, peut-être aussi, de marées analogues dans l'atmosphère.
En l'an 55 avant notre ère, Jules César faillit voir échouer l'une de ses entreprises à cause d'un mystère qu'il dut prendre pour un tour de magie monté avec une rare efficacité par ses ennemis. A l'époque, il s'apprêtait, à la tête de son corps expéditionnaire, à attaquer la côte sud de la Grande-Bretagne, quand ses marins, pourtant bien entraînés et disciplinés, se laissèrent abuser par les grandes marées de la Manche.
Au début de la campagne, les matelots, qui étaient habitués aux marées presque imperceptibles de la Méditerranée, n'avaient pas tiré leurs bateaux suffisamment haut sur la grève. Une très forte marée, doublée d'une tempête, causa alors de grave dommages à la flotte romaine. La campagne se poursuivit en dépit de cette catastrophe, mais César ne s'expliqua sans doute jamais quelles étaient ces forces qui, en quelques heures, avaient pu faire monter la mer si haut sur le rivage.
De nos jours, nous croyons savoir quelles sont ces forces, d'où elles viennent et pourquoi l'amplitude des marées varie tellement d'un point à un autre du globe. Mais certains aspects du phénomène des marées continuent de nous laisser perplexes. Comment, par exemple, les créatures marines s'habituent-elles au rythme des marées océaniques ? Est-ce une coïncidence si le cycle menstruel de la femme a la même périodicité que l'un des grands cycles des marées ? Pour aborder ces problèmes, il nous faut remonter aux fondements cosmiques des marées.
Les Anciens savaient que les marées étaient liées aux phases de la Lune, mais pour expliquer comment, il fallut attendre les démonstrations du Newton sur l'existence de la gravité et ses effets sur la matière. On comprit alors enfin que des forces gravitationnelles s'exercent entre tous les corps, et que leur intensité dépend de la taille de ces corps et de leur éloignement. Il devint donc clair que les mouvements des marées sont d'origine gravitationnelle, et que l'attraction qui s'exerce sur les eaux pour donner les marées hautes et basses est le résultat d'une machinerie complexe associant la Terre, la Lune et le Soleil dans l'infinité de l'espace.
La Lune et le Soleil exercent l'une et l'autre une attraction gravitationnelle sur les océans. Bien que la masse du Soleil soit 27 millions de fois plus importante que celle de la Lune, c'est le minuscule satellite naturel de la Terre qui a le plus grand effet sur les marées : 70%, contre 30% pour le Soleil. Ce phénomène est dû à la différence de distance du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre. Le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres alors que la Lune n'est qu'à 380 000 km en moyenne.
La Lune est donc le principal agent des marées, qu'elle provoque en soulevant les eaux qui se trouvent face à elle. Comme la Terre est animée d'un mouvement de rotation sur elle-même, les eaux se gonflent périodiquement pour donner les marées hautes. Sur presque toutes les côtes de la planète, un observateur installé en haut de la plage est témoin de deux marées hautes et deux marées basses par 24 heures. A première vue, il s'agit d'un phénomène surprenant car on pourrait ilaginer que la Lune, faisant le tour de la Terre en 28 jours et la Terre tournant sur elle-même en 24 heures, il ne devrait y avoir approximativement qu'une marée par jour.
Cette énigme apparente est élucidée par l'observation attentive de la danse orbitale qu'exécutent la Terre et la Lune. La vérité es qu'en fait la Lune ne tourne pas autour de notre planète ; ce serait plutôt les deux corps-célestes qui tourneraient autour d'un centre de gravité commun, situé sur une ligne droite qui relie leurs centres. Ce centre gravitationnel de l'axe Terre-Lune est situé à l'intérieur de la Terre, du côté où se trouve la Lune à ce moment-là.
Cela signifie que s'il y a un renflement produisant une marée haute sous la Lune, il y a aussi un autre renflement centrifuge à l'autre face de notre planète. Ce sont ces deux énormes bosses qui, dans presque toutes les régions du globe, sont responsables des deux marées hautes par jour.
Si l'on tient compte des effets combinés de la Lune et du Soleil sur les océans, on comprend mieux les variations du rythme des marées. L'une des raisons, qui frappait tant de devins et d'astrologue du passé, est la relation entre les phases de la Lune et la variation de la hauteur des marées sur une période de temps donnée, dont les fluctuation sont espacées de 14 et de 28 jours. Plus que tout autre phénomène naturel, cette intéraction entre la Lune et les marées montre comment les phénomènes cosmiques ont une influence sur les êtres humains. Chez un grand nombre de populations primitives, elle fut la source de nombreuses théories mystiques considérant l'homme dominé par l'influence d'autres corps célestes, comme les étoiles par exemple.
Ce sont les positions relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil qui créent les phases de la Lune ainsi que le schéma des grandes marées et des marées de morte-eau. Les grandes marées marquées par des marées exceptionnellement hautes et basses, se produisent aux époques de la pleine lune et de la nouvelle lune, à un intervalle d'environ deux semaines. La fréquence des marées de morte-eau, à la fois hautes et basses, est bien moindre. Les mortes-eaux se produisent entre les grandes marées et leur cycle est d'environ 28 jours.
Les liens mystérieux entre les marées et la forme de la Lune est dû, une fois encore à la gravité. Dans les configurations de grandes marées, la Terre, la Lune et le Soleil sont presque alignés, et les attractions gravitationnelles de nos deux compagnons célestes s'exercent donc sur la même ligne. Elles produisent ainsi deux renflements plus grands que la moyenne. A mi-chemin entre ces deux points culminants, le Soleil et la Lune forment un angl droit dont le sommet est la Terre. Ce qui implique que leurs forces d'attraction s'annulent en partie.
Les marées qu'on observe sur les côtés et celles qui se produisent au milieu des océans ont une périodicité plus complexes que les modèles simples indiqués plus haut ne pourraient le laisser supposer. Ce qui permet d'expliquer les immenses écarts de marées du type de celles qui laissèrent Jules César pentois. D'autres facteurs d'une infrastructure plus complexe, tel que la friction entre le fond des océans et les masses d'eau en mouvement, et le blocage physique de ce mouvement par les massescontinentales, expliquent les variations entre les types de marées d'une mer ou d'un océan à l'autre. Pour toutes ces raisons, et d'autres encore, la Méditérranée, mer relativement petite, a des marées de faible amplitude comparées à celles des côtes des grands océans.